State of Cinema 2020
Le temps présent du cinéma
J’ai une bonne nouvelle, pour tout le monde : le cinéma est en crise. Et d’une certaine façon c’est à peine une nouvelle, il n’a cessé de l’être depuis qu’il existe. C’est non pas le signal d’un danger pour le futur – le futur est une énigme et il faut beaucoup d’irresponsabilité pour tenter d’en formuler l’hypothèse, d’en prétendre déchiffrer les arcanes – mais plutôt celui d’une sensibilité, sismographique, aux enjeux du présent. Et je pense qu’il n’y a pas d’autre symptôme, plus pertinent, de la vitalité d’un art que sa constante remise en cause selon la constante reformulation de notre monde. La véritable question serait plutôt de savoir si les forces qui transforment le monde sont aussi celles qui transforment les arts, comment les unes se nourrissent des autres, à moins qu’elles ne soient antagonistes.
Il me semble qu’aujourd’hui une autre question se pose aussi et qui, à sa façon, parasite les deux autres, brouille les cartes, et opacifie notre lecture du cinéma et de son inscription dans sa propre histoire. C’est la nature de la réflexion qui détermine notre regard et la façon selon laquelle elle se structure. Historiquement, c’est-à-dire depuis le mitan de l’histoire du cinéma, son âge moderne, ce sont les outils de la cinéphilie qui définissent ce cadre, pensé par André Bazin, lui-même issu du christianisme social de Jacques Maritain. Le succès, et la pertinence de cette pensée tient à ce qu’elle ait été relayée par une génération de jeunes cinéastes, ceux de la Nouvelle Vague, pour lesquels l’écriture, celle de la théorie, a été la fondation de leur pratique. Réflexion et action étaient les deux pôles d’une dialectique qui aura été la clé de notre compréhension du cinéma et de ses singularités comme de ses paradoxes.
Pardonnez-moi de remonter si loin, plus d’un demi-siècle, pour traiter de l’état présent du cinéma, mais cette problématique du temps me semble vitale pour essayer de comprendre où, au juste, nous en sommes. C’est pourquoi il faudrait commencer par se poser la question de savoir à la fois ce qu’est au juste cette cinéphilie des origines et quelle aurait pu être son alternative.
A tort ou à raison je postule que toute réflexion sur le cinéma se fonde, consciemment ou inconsciemment sur la nature ambigüe des rapports qu’entretient le cinéma avec les autres arts. Et, partant, avec leur théorie. Dès les débuts du cinéma, s’opposaient les tenants d’un cinéma inscrit dans l’histoire des avant-gardes, puisqu’il en était synchrone, d’une part, et ceux de son intrinsèque bâtardise de l’autre – tiraillé entre la littérature populaire et l’imagerie symboliste. André Bazin et les Cahiers du cinéma ont choisi, eux, d’interroger la praxis et de construire à partir de celle-ci une bulle essentialiste. Le cinéma serait ailleurs, étranger aux problématiques anciennes.
C’est autour de cette démarche que se sont fédérées les diverses nouvelles vagues ayant essaimé à travers le monde.
Au centre se trouvait la question du filmage et de son éthique, et la liberté de l’auteur, autorisant toutes les idiosyncrasies. Mais dès le tournant des années 60, et de façon plus extrême par la suite, cette cinéphilie a été prise dans une double tenaille : celle du rapport refoulé avec les arts plastiques d’une part ; Jean-Luc Godard ayant fait de cette question le centre de son travail ; et l’évolution socio-politique du monde, bousculé par le mouvement de la jeunesse tel qu’il s’est matérialisé en France par Mai 68 et aux Etats-Unis par le « Summer of Love » de 1967.
Pour le résumer simplement le rapport aux arts plastiques interrogeait la forme du cinéma moderne, son rapport à la figuration, à la narration, tandis que la lame de fond qui a balayé les sociétés contemporaines interrogeait la place, voire la légitimité de l’auteur.
Tout ce qui semblait clair s’est brouillé, tout ce sur quoi s’était construit un nouveau cinéma était dès lors remis en cause, y compris par ceux qui en furent les principaux artisans.

J’ai personnellement été marqué par cette question profonde et insoluble de l’appartenance ou pas du cinéma à la problématique des arts plastiques. Le cinéma est-il, comme on en use fréquemment sans trop bien comprendre ce qu’on dit, le « 7ème art » ou bien est-il autre chose qu’un art et pourquoi pas cette pierre philosophale dont l’histoire des avant-gardes du 20ème Siècle a fait l’objet de sa quête, le dépassement des arts, au sens hégélien du terme. Le cinéma en tant qu’art, certes, mais qui aurait ce pouvoir de regarder les autres arts, de résoudre les mystères de la représentation du monde, bref d’accomplir ce prodige de la reproduction de la perception dans son entièreté et dont l’accès hante l’histoire de la peinture – ainsi c’est par l’abstraction que Turner a résolu la quête du mouvement qui a fondée sa peinture.
Je pense souvent à cette phrase d’Ingmar Bergman disant de Tarkovski qu’il évoluait librement dans des espaces à la porte desquels il avait lui-même frappé toute sa vie.
En ce sens j’ai toujours été embarrassé des malentendus suscités par une distinction entre le cinéma expérimental, héritier des tentatives des dadaïstes (Hans Richter), des surréalistes au début du 20èmeSiècle (Man Ray, Buñuel) et le cinéma narratif tel qu’il s’est imposé très tôt en tant que divertissement populaire ayant graduellement acquis ses lettres de noblesse. Ainsi Traité de bave et d’éternité du fondateur du lettrisme, Isidore Isou, doit selon moi être considéré comme annonciateur dès 1951 de la Nouvelle Vague. Et, de l’autre côté de l’Atlantique, la semblable rupture opérée par une génération de cinéastes expérimentaux récusant tout ce qui les avait précédés, Kenneth Anger, Andy Warhol, Jonas Mekas, Stan Brakhage ou encore John Cassavetes, est fondatrice du cinéma libre à venir, du Nouvel Hollywood, si l’on préfère. En particulier en termes d’une reformulation formelle de l’esthétique du cinéma qui aura beaucoup moins concerné la Nouvelle Vague. Surimpressions et magie noire (Anger), abstraction (Brakhage), écriture diaristique (Mekas), dramaturgie et statut de l’acteur (Cassavetes), usage du zoom en tant que réinvention du plan fixe, libéré du statisme de la camera obscura (Warhol), ce n’est pas la syntaxe mais la texture même du cinéma qui est en jeu.
Pour ma part je vois le cinéma comme un tout : le cinéma narratif s’est toujours nourri des travaux expérimentaux de la même façon que ceux-ci ont toujours été inspirés par les limites ou encore les impasses de la figuration. Je dis cela dans la mesure où il y a du Brakhage chez Michael Bay et du Warhol chez Fassbinder ou Almodovar.
Au cœur de ces questions, comme souvent lorsqu’il s’agit d’interroger le contemporain, l’œuvre de Jean-Luc Godard, initialement issue de la cinéphilie classique et hantée, jusqu’au crépuscule, par son questionnement de celle-ci et par le doute qui la ronge, nœud de la souffrance qui depuis longtemps déjà définit son art.

La théorie c’est la pensée en mouvement, dans sa capacité à s’emparer, y compris en termes stratégiques de la problématique, d’un présent qui se redéfinit sans cesse. A quel moment, quand au juste, le cinéma a-t-il cessé d’être pensé ? Quand a-t-il perdu le lien vital, essentiel qui lie l’exercice d’un art et sa réflexion ? Je crains que de nombreuses forces, irrésistibles, aient contribué à ce que je persiste à percevoir comme l’échec d’une génération.
En tout premier je dirais que le cinéma a été victime de son prestige, et la théorie (auteuriste si l’on veut) de son succès international qui lui a ouvert toutes grandes les portes de l’académie. Dès lors que la pensée du cinéma est devenue une discipline universitaire, elle s’est figée, elle a cessé d’être le prolongement des préoccupations matérielles, pratiques, des cinéastes. Qui, au juste, s’intéresse aujourd’hui, sérieusement, à la question de l’espace tel qu’il est transformé par les optiques, en particulier les longues focales spécifiques au cinéma moderne ? Qui s’interroge sur la perspective monoculaire en tant que limite à la restitution du réel par le cinéma ? Ou, encore une fois, qui explore la disparité entre le champ ouvert, libre, de l’écriture romanesque, du théâtre moderne, et les étroites limites des conventions qui régissent les travaux des comités, des commissions qui déterminent la vie ou la mort des œuvres cinématographiques ? Et je ne parle même pas des séries dont les porte-drapeaux semblent trop heureux d’avoir l’occasion d’appliquer les tissus de conventions et de platitudes énoncées par les manuels de scénario américains.
Là où je veux en venir c’est à ce moment où la théorie, vivante, devient idéologie, morte. Entre les mains de professeurs d’université qui y trouvent l’occasion de donner un vernis de modernité à leur enseignement, la pensée en mouvement devient une doxa, un assemblage de règles, d’automatismes, qui ne sont plus fondés sur rien puisqu’on a oublié la source même, et combien c’était celle de la jeunesse et de la poésie la plus spontanée.

Si je voulais prolonger ma réflexion d’un pas supplémentaire, et être plus provocateur que je ne souhaite l’être dans ce contexte, je dirais qu’il est aujourd’hui temps de se confronter sérieusement, et avec responsabilité, à l’échec de la cinéphilie. Je ne le dis pas dans le sens où il faudrait remettre en question ses acquis, ni même l’importance capitale qu’elle a eu dans la pensée de l’image au 20ème Siècle : sa place est l’une des plus hautes. Mais c’est précisément du fait de cette réussite, de ce trésor de l’histoire du cinéma, qu’il faudrait ouvrir les yeux et admettre qu’elle est un moment du cinéma, que ce moment est passé, depuis longtemps, en cela qu’il ne produit plus rien de neuf, sinon une forme de tétanie induisant que la totalité du cinéma aurait été pensée à l’heure de la modernité des années 60 et auparavant à l’heure de son âge classique, et qu’il ne nous resterait aujourd’hui qu’à nous contenter des valeurs et des outils d’une postmodernité ironique, ou plutôt non-dupe, lorsqu’elle ne bascule pas dans les grimaces du baroque.
Ce que je veux dire c’est que dans le monde de la prolifération des images, de toutes natures, on ne peut que constater la fragilité de la place de la pensée cinéphile qui est devenue une position de repli quand elle se trouvait autrefois, il y a peu, au centre du débat.
Une fois ses grands principes acquis, le film reconnu comme objet d’étude légitime, son auteur ayant acquis des prestiges autrefois réservés aux praticiens de disciplines plus anciennes et plus sérieuses, et reconnue sa légitimité à se situer à mi-chemin entre haute et basse culture, il me semble qu’on n’a plus avancé d’un pouce ; et ce que j’ai vu se construire, ce sont les murs d’une forteresse – oui, universitaire – afin de protéger, autour des gardiens de ce temple, des valeurs n’ayant depuis longtemps plus produit grand-chose de bien utile ou de bien pertinent.
Et je le dis avec d’autant plus de malaise que je me place ici dans ma position non seulement d’essayiste mais aussi dans celle de cinéaste qui interroge la théorie, qui pose la question de savoir, de comprendre en quoi celle-ci m’aurait été utile, m’aurait été stimulante, au-delà de ce que j’ai appris en contribuant aux Cahiers du cinéma durant cinq années, entre 1980 et 1985. La réponse, en ce qui me concerne, pour d’autres elle pourrait – peut-être – être différente, est brutale, le mot est : rien. Et même, comme la nature m’a plutôt doté d’un esprit de contradiction, il me reste ce sentiment d’avoir au contraire dû nager à contre-courant des conceptions éphémères, des gri-gris, des modes aussitôt oubliées d’une pensée cinéphile à la dérive, déterminée par un rapport tardif à la sociologie bourdieusienne, tâtonnant dans les jeux de miroir de la postmodernité et courant, naïvement, à la poursuite des prestiges des arts plastiques depuis que ceux-ci ont envahi le domaine de l’image animée à travers leur pratique, pourtant bien fragile et bien discutable, de l’installation.

Laissez-moi, s’il vous plaît, revenir une dernière fois en arrière avant d’en venir à des considérations moins négatives, encore que je sois, à bien des égards, partisan des pouvoirs du négatif qui ont joué un grand rôle dans mon inspiration.
Lorsque s’est constituée la cinéphilie historique à la fin des années 50 et au début des années 60, la pensée des arts plastiques avait-elle quoi que ce soit à dire du cinéma, de son histoire et des puissantes forces qui déterminaient sa mue. A mon avis pas grand-chose, et il n’y a pas besoin d’être, comme c’est mon cas, un lecteur de Guy Debord et des situationnistes pour observer que durant ces années, face à l’avènement de l’école de New York (Pollock, de Kooning, Rothko…), la principale question qui agitait les avant-gardes européennes était celle de leur propre échec politique et celle du ressassement des impasses de l’abstraction, de la répétition de transgressions qui ne choquaient déjà plus personne en 1930. Le cinéma était fort loin des préoccupations de la théorie des arts plastiques, tant il renvoyait, y compris dans ses déclinaisons les plus contemporaines, comme le néo-réalisme italien, à la reproduction monoculaire du monde la plus primaire. La question de la figuration telle qu’elle était portée, par le cinéma, semblait négligeable face à l’exploration des obscurités, ou encore des éblouissements de l’inconscient à travers les moyens de l’abstraction et, à plus forte raison, face au mouvement de la négation de l’art par le biais du happening, de ses déclinaisons les plus radicales, les plus extrêmes, comme l’actionnisme viennois. Ou, encore une fois, les Thèses de Hambourg de Debord, Vaneigem et Kotanyi marquant le renoncement à l’art des situationnistes en faveur de la « réalisation de la philosophie ».
J’écris cela pour rappeler combien la pensée cinéphile a aussi été un puissant antidote aux forces destructrices à l’œuvre au sein des avant-gardes et combien elle a permis aux cinéastes débutant alors, sans doute la génération la plus riche, la plus prolifique, de l’histoire des films, de trouver un socle à une pratique de la représentation du monde là où les arts plastiques le leur refusaient.

Il va bien falloir en venir au présent. Je vais essayer de le faire. J’aimerais commencer par la question de la théorie dès lors que je récuse la cinéphilie telle qu’elle s’est ossifiée en idéologie et en dogme.
Dans son récent livre Une histoire des images, David Hockney que je considère comme le principal penseur contemporain de l’image, au-delà d’être le plus grand peintre vivant, poursuit une réflexion passionnante sur les origines de la représentation : comment elle s’est longtemps construite autour d’un rapport à la perspective monoculaire, donc l’évolution technique des optiques et leur usage, et la technique de la camera obscura. Autant ces outils lui permettent une relecture infiniment stimulante de l’âge classique de la peinture, sa problématique est aussi celle de leur remise en question moderne. Le moment cubiste étant de ce point de vue une charnière déterminante, rompant, par la multiplication des angles au service d’une même image, avec les repères traditionnels de la perspective.
A mon sens Hockney ne va pas assez loin, au moins en ce qu’il n’est pas relayé par la théorie du cinéma qui au fil de temps aura oublié d’être une théorie de la perception – sauf chez Gilles Deleuze qui, essentiellement dans L’Image mouvement, aura été l’un des tout derniers grands penseurs du cinéma. C’est en effet du point de vue du mouvement – et de la multiplication des optiques et des axes au sein non pas du plan qui n’est pas le vrai syntagme du cinéma, mais au sein de la séquence – que se joue la question du cinéma en tant que réponse aux interrogations de Hockney, en tant que remise en jeu des limites de la camera obscura des origines. Le déplacement de la caméra, depuis qu’elle peut être portée, et l’usage, y compris en intérieur, des longues focales, depuis qu’on dispose d’optiques suffisamment sensibles pour cela, nous rapproche en effet, et à mon sens de plusieurs pas, de la reproduction de la perception, enfin à portée de main.
Hockney refuse de voir ces questions à l’œuvre dans le cinéma, c’est la limite de sa réflexion, mais il me semble que sa dernière percée, dans son ouvrage le plus récent, est essentielle en tant qu’elle suggère de replacer le tableau au cœur de l’histoire des images. Pour le résumer schématiquement il considère que le glissement de la peinture à la photographie n’est pas une rupture mais une continuité où l’invention déterminante n’est pas tant la reproduction du réel, rivale de la peinture, que la capacité à fixer – sur papier photo – une image que la peinture connaissait depuis longtemps, de par son usage des optiques, et qui était à la source de ses techniques et de l’évolution de celles-ci.
L’importance de cette idée tient à ce qu’elle relégitime au sein du cinéma, dont il n’est pas abusif de dire qu’il est le prolongement de l’invention de la photographie, la théorie artistique telle qu’elle s’est développée autour de la peinture à travers les âges. Au fond la question que j’essaye de poser serait de savoir si aujourd’hui le cinéma n’aurait pas intérêt à se confronter aux riches réflexions qui, depuis la Renaissance se préoccupent de penser à la fois la question de la reproduction du monde et celles plus essentielles encore ayant trait à l’exploration de la perception. On me demanderait ce qui me semble le plus utile à enseigner dans les écoles de cinéma d’aujourd’hui, ce sont ces deux pistes que je recommanderais.
D’ailleurs il suffirait pour étayer ces intuitions d’observer combien les penseurs de l’image auxquels Jean-Luc Godard – le plus authentiquement plasticien des grands cinéastes modernes – se réfère le plus souvent sont Elie Faure, mais surtout André Malraux dont les fulgurances et les stupéfiantes juxtapositions, les courts circuits théoriques, n’ont certainement pas fini de nous interroger.
Ce que j’essaye de dire là c’est combien la cinéphilie est peu armée pour affronter ces questions, qui sont au cœur de la compréhension de ce mystère, dont les données mêmes semblent encore nous échapper, celui de la nature contemporaine du cinéma. Là où l’histoire des arts nous propose de riches et stimulantes opportunités de réinventer notre rapport aux images mouvantes et, peut-être, de le replacer dans une histoire longue que l’opposition entre cinéma classique et modernité, un temps productif, a fini par opacifier.

Qui pense le cinéma aujourd’hui, de quel point de vue et au nom de quelles valeurs ? Et que pense le cinéma de lui-même au nom de quelle éthique et selon quels principes ? Deux questions d’ordre bien différent et dont les réponses semblent s’être fragmentées – en particulier sur internet – et dont il devient infiniment difficile de réunir la cohérence.
Vu depuis un angle limité, celui du cinéma français, il m’a semblé, bien que je n’aie pas moi-même participé de cette question, que les personnalités fortes de Serge Daney et de Claude Lanzmann ont un temps servi de repère, fondant une sorte de post-scriptum funèbre à la cinéphilie, plutôt post-gauchiste que post-moderne, et définie par la question de l’interdit : d’une part le « travelling de Kapo » critiqué dans un essai de Jacques Rivette à propos d’un film de Gillo Pontecorvo (auteur de La bataille d’Alger et idole jusque-là indéboulonnable du cinéma anticolonialiste) et qui devient chez Daney l’obscénité même, l’esthétisation de la déportation, à l’heure où il donne une forme littéraire, bouleversante, à son histoire personnelle jusque-là refoulée, autour de la figure de son père, jamais connu, juif polonais, victime des camps.
Claude Lanzmann, auteur d’un étonnant chef d’œuvre, Shoah, se saisissant de façon transcendante de la déportation, en s’interdisant d’user d’images d’archives, a quant à lui construit autour de cette question une éthique du cinéma qui a marqué les esprits.
La combinaison de ces deux problématiques a tenu lieu de théorie à une génération de cinéastes eux-mêmes rarement concernés de façon directe par ces questions historiques mais en quête d’une morale que les ruines de la cinéphilie classique, déjà ébranlée de façon décisive par le gauchisme, était incapable de leur fournir.
C’est le paradoxe de ce moment de la théorie du cinéma de n’avoir rien eu à proposer de façon constructive sinon d’établir une sorte de code de la restriction. Assorti du spectre, agité complaisamment, de la mort du cinéma. Je n’aurais pas aimé commencer à faire du cinéma dans cette ambiance délétère, et c’est à Arnaud Desplechin, avec La Sentinelle – un film dont j’ai toujours pensé qu’il aurait beaucoup plu à Serge Daney – qu’il a été donné de dénouer ce nœud, d’arracher le cinéma à cette malédiction. Mais au fond n’y avait-il pas une vérité là-dedans et Serge Daney, qui dans le courant des années 70 avait pris en marche le train post-bazinien, n’avait-il pas une certaine lucidité quant aux impasses de la cinéphilie autour de laquelle il s’était constitué et qu’il voyait se défaire, se décomposer, se renier, aussi, alors qu’il était lui-même mourant.
Que reste-t-il de ces questions, persistent-elles, ont-elles passé les frontières de la France ? Pas vraiment. Parlent-elles aux jeunes cinéastes ? Ont-elles une postérité, sont-elles seulement pertinentes dans le cadre de cette réflexion sur l’état présent du cinéma ? A peine.

Si l’on se pose la question d’identifier le lieu d’une reformulation de la cinéphilie d’aujourd’hui, il est impossible de ne pas le situer sur internet et la façon dont s’y sont redéfinis non seulement les modes de visionnage du cinéma, mais la façon dont nous circulons à travers son histoire. C’est un lieu commun sans intérêt et pourtant une vérité toujours bonne à rappeler que les générations d’aujourd’hui disposent d’un accès infiniment plus large à l’histoire, à toute l’histoire du cinéma, comme à son présent, inimaginable pour l’humanité pré-numérique qui n’a jamais eu accès autrement que grâce à la Cinémathèque à une fraction des chefs d’œuvre du cinéma, certains d’entre eux étant parfaitement inaccessibles.
On ne voit pas tout mais on a accès, y compris gratuitement, à presque tout ; la cinéphilie s’y est dissoute en une infinité de chapelles antagonistes, chacune articulée autour d’un fragment d’un passé glorieux, au point que sa valeur, même symbolique, n’en finit pas de se dévaluer. Il reste des films, souvent très bons – on fait aujourd’hui plus de bons films qu’à à peu près n’importe quelle autre époque – dont les enjeux se jouent au coup à coup : aura-t-il l’Oscar, la Palme, le Lion, l’Ours, aura-t-il des nominations ? Tandis que les cinéastes en tant qu’auteurs, eux, s’effacent. Qui aujourd’hui sait suivre le fil d’une œuvre, comprendre ce qui est au travail dans la quête, y compris insensée, y compris vaine, d’un artiste ? Non, il ne s’agit plus que de ce film-là, au prochain tout sera à rejouer. Au fond, y compris cet héritage de la cinéphilie auteuriste, est aujourd’hui questionné dans la fragmentation numérique et la dilution de la pertinence théorique qui s’y opère.
Quelle théorie dialogue-t-elle avec le cinéma au temps présent, quelle théorie a-t-elle droit de cité, d’infléchir l’inspiration des cinéastes. A qui, sur ce registre, y a-t-il des comptes à rendre. En fait, on a un peu peur de la réponse.

Il me semble que c’est la sociologie – on dit plus facilement le politique – et le communautarisme. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Et ne suis-je pas moi-même en train de m’aventurer sur un terrain fragile, mouvant. Je crois qu’il y a une injonction à aborder ces questions, même si je doute d’être capable de formuler une réponse satisfaisante et, à plus forte raison, consensuelle.
Nous connaissons les maux de notre époque. Réchauffement climatique, désastre écologique, accroissement démentiel des inégalités sociales, gestion impossible des flux migratoires et, surtout, incapacité des gouvernants, des états, à donner à ces sujets anxiogènes, et je ne parle ni des guerres, ni des épidémies, ni du chômage, une réponse satisfaisante ou même vaguement rassurante. A l’opposé, on dirait que l’opposition autodestructrice à l’appréhension de ces maux serait dans nos démocraties devenue un atout électoral.
Que les cinéastes soient citoyens et légitimement partie prenante des enjeux qui traversent la société, rien de plus normal à cela. Mais le politique est le domaine du complexe et il ne produit pas nécessairement du bon cinéma. Par ailleurs, le cinéma de fiction peine, et c’est bien naturel, à se saisir des enjeux de société qui sont bien mieux analysés ou représentés par l’édition, la presse ou même le documentaire, formes plus longues et de ce fait plus légitimes et disposant de la capacité à traiter des sujets fragiles ou sensibles avec la rigueur, la précision, l’exigence qu’ils imposent et que le cinéma ne peut que très exceptionnellement leur conférer.
De mon point de vue, le sociologique est une mauvaise branche à laquelle se rattraper, y compris dans le sens où les simplifications, les amalgames, et la dramatisation risquent de tronquer les faits, de les réduire à des généralités confortables et au résultat susciter une lecture erronée et tout aussi bien nocive.
Je ne souhaite pas, en cela, critiquer ou délégitimer un cinéma qui voudrait rendre des comptes à la cité et aux citoyens, c’est au contraire parfaitement louable. Je me contente de dire que je trouve cela très difficile, et même parfois dangereux, et qu’en tout cas je n’y discerne pas une clé qui permettrait de penser le cinéma contemporain de façon satisfaisante ou stimulante, et celui du futur encore moins.
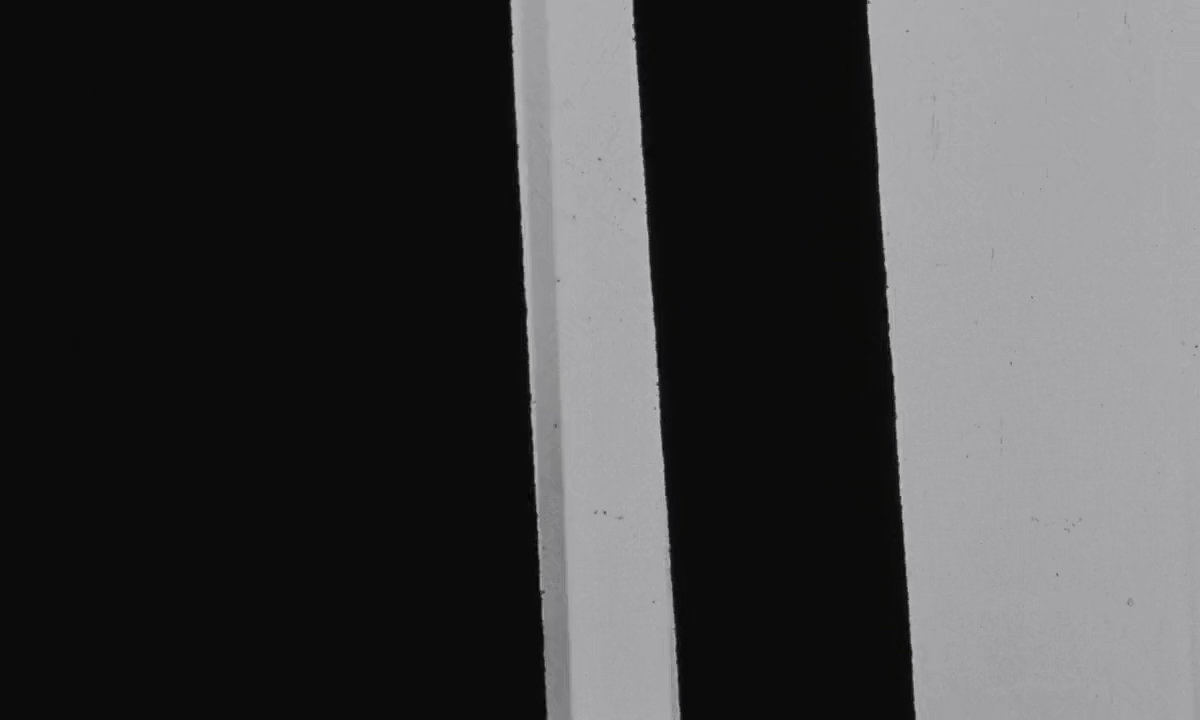
Que penser du communautarisme qui est devenu un facteur agissant dans nos sociétés et qui à son tour interroge le cinéma faute d’être interrogé par lui, ce qui me semblerait plus profond, plus risqué et au fond plus satisfaisant pour l’esprit ; j’ai en effet toujours eu la conviction que le rôle du cinéma, le rôle de l’art, est d’interroger la société et certainement pas d’être interrogé par elle, surtout selon une censure qui de tous temps a été le propre des régimes totalitaires.
J’ai été adolescent durant les années 70, je l’ai souvent répété et je persisterai à le faire tant cette période, et sa remise en cause de toutes les valeurs de la société, m’a marqué. J’ai vécu, et j’ai été activement partie prenante d’une contre-culture qui prônait la libération de la vie quotidienne, et engagé dans des formes du gauchisme qui favorisaient la libération de l’individu plutôt que les utopies collectivistes et le soutien à des régimes autoritaires, voire génocidaires. J’ai vu la libération de la parole et de la pratique homosexuelle, j’ai vu le renouveau du féminisme et les victoires déterminantes qu’il a remportées, j’ai vu l’invention d’une identité franco-maghrébine, d’une culture issue des cités où étaient relégués les immigrants africains encouragés à s’installer en France pour servir de main d’œuvre aux grands travaux d’infrastructure de la France gaulliste.
Je me suis, par la suite, moins intéressé aux dérives identitaires qui ont découlé de ces avancées, ni de leur instrumentalisation politique ou idéologique. Peut-être étaient-elles fatales, peut-être étaient-elles nécessaires, je n’en sais rien. Pour ma part, je n’ai jamais pensé mon rapport à autrui en fonction de la couleur de sa peau, ou de ses préférences sexuelles. Quant à mon rapport aux femmes et au féminisme – qui aura été toute ma vie mon parti politique de prédilection tant je suis convaincu que dans notre monde la virilité malade est devenue la source de tous les maux – c’est Groucho Marx qui en aura donné la meilleure définition quand il disait que les hommes sont des femmes comme les autres. Je ne saurais pas mieux dire.
Ces commentaires plus personnels pour définir non seulement qui je suis mais, en l’occurrence, « d’où je parle » pour reprendre le jargon des années politiques. En cela je dis que le cinéma peut être communautariste – il n’a à mon sens nulle vocation à l’être, mais pourquoi pas – mais ce communautarisme n’a néanmoins aucune pertinence à se substituer à cette absence de pensée théorique du cinéma dont on est bien obligé aujourd’hui de faire le constat.

Il faut bien que j’en vienne à Hollywood. Je n’ai pratiquement rien de positif à en dire sinon que la prospérité de cette industrie et ses nouvelles modalités ne me réjouit en rien, elle m’effraie, elle me révulse même, tant ce qui s’y est produit ces dernières années va à l’opposé de ce que j’ai pu aimer ou admirer dans un cinéma américain qui a tous les âges de l’histoire du film a donné à cet art la majorité de ses plus grands maîtres.
Nous assistons au triomphe des séries, de la diffusion des films sur des plateformes numériques et à la confiscation des écrans au service de franchises réunies pour la plupart au sein du studio Disney dont l’hégémonie semble désormais absolue.
En effet, pourquoi se donner la peine de financer un cinéma n’ayant pas vocation à susciter de sequel, de spin-off, de in the universe of et dont le rapport au public, hasardeux, est imprévisible ; depuis longtemps déjà, à Hollywood, le territoire du film ne fait que se réduire. Au profit d’un cinéma indépendant contraint à se contenter de budgets dérisoires – et en cela limité dans sa pratique de la syntaxe contemporaine du cinéma, réservée aux productions majoritaires.
Et Netflix, et Disney Plus, et Apple, etc… : le cinéma ne s’y est-il pas réfugié ? Alfonso Cuaron, Martin Scorsese, les frères Safdie, Noah Baumbach n’y ont-ils pas trouvé l’asile politique ? Et je l’ai fait moi-même puisque mon film Wasp Network est diffusé par Netflix dans les principaux territoires à l’exception de ceux qui avaient été prévendus, en tout premier la France où il a rencontré un honnête succès public sur grand écran. Aucun autre distributeur ne proposait aux producteurs du film d’alternative viable.
S’il y a une question sur laquelle bute aujourd’hui la pensée du cinéma – et qui bénéficierait grandement de disposer d’outils théoriques qui nous manquent cruellement – c’est bien celle de la confusion générée par la transformation en profondeur de la diffusion et du financement des films. Tout d’abord, les plateformes ont-elles vocation à financer un cinéma d’auteur contemporain ambitieux, au-delà de l’effet de notoriété tout à fait circonstanciel qui relève de la rivalité sur ce terrain avec de nouveau entrants bien décidés à s’approprier une importante part du marché ? En d’autres termes, Netflix qui a aujourd’hui encore besoin de prestige, de valeur symbolique, en aura-t-il encore besoin l’année prochaine, ou celle à venir ? A mon avis pas vraiment. Quant aux studios, reviendront-ils au film en tant que modèle économique ou bien la dérive vers les franchises d’une part et les séries de l’autre est-elle actée ?
En somme y a-t-il, reste-t-il, de la place pour un cinéma libre sur grand écran ? Je crois que cette fenêtre est en train sinon de se fermer, tout au moins de se réduire à vue d’œil. Reste pour seul vrai modèle un cinéma indépendant, radical, audacieux, mais à la diffusion hélas limitée.

Suis-je à l’aise avec cette idée ? Pas vraiment. Je viens, à mes débuts, des arts plastiques, j’ai été influencé par la poésie contemporaine et mes goûts musicaux m’ont le plus souvent conduit à m’attacher à des artistes situés dans la marge de la marge, et je ne parle même pas de mes convictions, esthétiques, philosophiques, politiques, terriblement minoritaires au sein de ma génération. Mais si j’ai choisi de me consacrer au cinéma c’est parce qu’il était majoritaire, parce qu’il était la dernière forme d’art à résonner jusqu’au plus profond de la société, à ne pas être enfermé dans sa forteresse, à ne pas avoir subi l’accablante dérive des arts plastiques qui ont choisi de faire alliance avec le capitalisme financier triomphant, qui ont fait le choix d’une fausse radicalité cynique, ce que Guy Debord appelait le « dadaïsme d’état », destinée à les valoriser jusque dans la stratosphère.
Le cinéma qui m’a inspiré, celui que j’ai aimé, celui que j’ai essayé de pratiquer est un cinéma impur, ouvert, et accessible en particulier à ceux pour qui le cinéma est l’occasion souvent unique d’avoir à faire à l’art en tant qu’il peut être vital, bénéfique et, pourquoi pas, salutaire.
En ce sens, est-ce que je pense que Alfonso Cuaron, Martin Scorsese, les frères Coen, et tant d’autres ont eu raison de choisir une forme de sécurité et de confier leurs films à Netflix ? Non, je ne le crois pas. Je pense que leurs films sont la démonstration même que le cinéma auquel je crois est vivant, qu’il est viable – la plupart de ces films auraient pu être financés sans trop de difficultés en dehors de Netflix et des autres plateformes – et qu’il est le prolongement, la continuation d’un art qui est celui de notre époque, de notre génération, celui qui rend de la façon la plus épidermique, la plus sensible, compte de la transformation du monde, des êtres, du temps, autant de choses qui appartiennent au cinéma et qui, dans le flux des images, risquent de se perdre, de s’oublier ; et, même si j’ai peu de certitudes, je suis certain que ce danger est bien réel et que s’il y a une chose qui doit nous réunir, c’est d’y faire face et de tenir bon, aussi puissantes que soient les forces auxquelles cela nous impose de nous confronter.

A ce stade, mon lecteur est en droit de me demander ce qu’est au juste cette théorie absente et dont le cinéma au temps présent aurait besoin. Il me semble déjà avoir évoqué cet aller et retour indispensable entre la pratique, souvent déterminée par l’usage de nouveaux outils ou de nouveaux supports, intuitive, spontanée, incontrôlée, et sa pensée. Je ne veux pas dire par là que l’évolution des arts serait la parole de la pythie et qu’il reviendrait aux critiques, aux essayistes, à certains cinéastes aussi, comme je suis en train de le faire, de tenter d’en déchiffrer les énigmes. Mais je pense tout de même qu’il peut être important, et peut-être même essentiel que l’œuvre puisse susciter cette ekphrasis dont parlait Roberto Longhi, c’est à dire ce discours qu’autorisent, que provoquent, les questions, les énigmes, les percées, que l’art dans sa quête du vivant et de ses contradictions laisse irrésolues. Une écriture qui serait dialogue avec les artistes, révélation de l’œuvre et par cela même intercessrice avec le spectateur.
Je l’entends au sens le plus littéral, celui de savoir lire et répondre aux questions soulevées au jour le jour par la pratique du film, mais je voudrais aussi pousser cette question un peu plus loin et l’ouvrir à deux champs qui dans le contexte actuel me paraissent riches de potentialités, il s’agit d’abord de l’inconscient et ensuite de l’éthique.

Ici, plus qu’ailleurs, je dois parler à la première personne et partager des préoccupations qui m’ont toujours hanté y compris lorsqu’elles perdaient du terrain dans la réflexion sur le cinéma et dans l’inspiration des cinéastes.
Appliquée au cinéma et, s’il vous plaît, pardonnez-moi les simplifications et les raccourcis qu’impose l’approche d’un si vaste sujet, c’est sous deux formes différentes que la psychanalyse peut nous éclairer. La première, freudienne, pour résumer, nous rappelle que dans son appréhension des personnages et de leurs actes, l’auteur n’est jamais tout à fait conscient de ce qu’il fait de la même façon que l’écrivain, prenant sa plume, n’écrit pas toujours ce qu’il avait prévu d’écrire, l’écriture révélant la pensée plutôt que la pensée figeant l’écriture : bref je veux dire que le cinéaste comme l’auteur, aussi lucide soit-il, ne sait pas toujours ce qu’il dit ni ce qu’il fait car c’est son inconscient qui est au travail.
En d’autres temps, pas si éloignés, cette problématique allait de soi et c’était dans la réflexion autour des personnages d’Ingmar Bergman ou bien de Michelangelo Antonioni, ou encore de Jacques Tati, qu’on allait chercher ce qui animait, ce qui déterminait l’individu moderne, pour le meilleur comme pour le pire. Je crois qu’il pourrait en être de même aujourd’hui, à une époque où le sens des films, sous ses multiples formes, est un sujet de débat, de polémiques, et cela plus que jamais. Dans les films, ainsi que dans toute œuvre de l’esprit, c’est l’inconscient qui agit, c’est à dire que nous lui ouvrons les portes et rien n’est plus précieux que ce qu’il dit à travers nous dès lors que nous nous interdisons lieux communs, facilités, conventions et toutes les fausses règles dramaturgiques qui déterminent les comités, les commissions dont hélas trop souvent dépend le présent et le futur du cinéma, limitant et déformant l’authentique inspiration et les authentiques désirs des jeunes cinéastes auxquels les règles dominantes de l’industrie du cinéma apprennent à ne pas être eux-mêmes.
L’autre dimension selon laquelle la psychanalyse définit le cinéma, je l’appelle, bien schématiquement, jungienne, en cela que le cinéma, la totalité du cinéma, y compris sous ses formes les plus conventionnelles et les plus primaires peut – et, selon moi, doit – être lu en tant qu’inconscient collectif. Le monde des images, le fantastique, l’imaginaire, où qu’il nous mène et souvent au plus décevant ou au plus banal, est le rêve de notre société et nous informe, souvent sans le savoir, sur l’état du monde mieux que tout autre art, à l’exception peut-être des chansons, de la variété, de la musique populaire sous toutes ses formes, qui rendent compte en temps réel des flux qui traversent notre présent.
Ainsi, pour prendre un exemple, j’ai toujours vu Star Trek comme un regard, quasi documentaire, sur la vie de bureau et les interactions entre les employés, tiraillés entre leur routine quotidienne et les dangers du monde extérieur ; je n’ai réalisé que plus tard ce qui littéralement crevait les yeux, leur vaisseau spatial s’appelle en effet « Enterprise », l’entreprise…
Sur un registre plus sombre il est difficile de ne pas voir dans la prolifération de films généralement hantés par la destruction et la fin du monde, et construits autour des superhéros Marvel, une sorte de vengeance de l’identité masculine mise en danger par la redéfinition de la place de la femme dans les sociétés modernes.
Et je choisis à dessein deux pistes assez primaires dans la seule intention de montrer que si l’on tire ces fils, cela peut contribuer à penser les vérités, y compris déplaisantes, qui animent notre temps.

J’en viens à l’éthique.
Elle mérite d’être interrogée même si l’état présent du cinéma risque de nous donner peu de réponses faciles ou satisfaisantes.
Ce n’est pas en termes de morale que pour moi la question se pose, dans la mesure où la plupart des œuvres d’Eisenstein ou de Vertov pourraient être définies comme relevant de la propagande, que Rossellini lui-même a fait des films approuvés par l’état fasciste, qu’il peut être douloureux de regarder l’un des chefs d’œuvres de l’histoire du cinéma, Naissance d’une nation, que Bergman, Hitchcock et de nombreux artistes parmi les plus remarquables de l’histoire du cinéma ont réalisé des films de guerre froide. Cela n’ôte rien à leur génie, aux uns comme aux autres. Et je n’oublie pas Leni Riefenstahl dont la place – importante – ne lui est niée que du fait de son nazisme et des bénéfices qu’elle en a retiré. Un grand cinéaste comme Xie Jin, l’auteur inspiré de Sœurs de scène et de La basketteuse N°5 n’a eu aucun scrupule à poursuivre sa carrière aux heures les plus noires de la Révolution Culturelle.
Je vois plutôt la question sur le registre de la pratique, comme lorsqu’André Bazin parlait de « montage interdit » quand on assemble deux plans de nature antinomiques, une bête sauvage d’une part, un acteur déguisé en explorateur de l’autre. Ou lorsque Claude Lanzmann, que je citais plus tôt, interroge la légitimité de représenter, de fictionaliser les camps de concentration et les chambres à gaz. Chacun a le droit d’argumenter et de défendre son point de vue sur cette question, elle n’en est pas moins pertinente et, surtout, a le mérite de pousser jusqu’à son extrémité une question qui se pose à une échelle moindre dans chaque geste de la pratique du cinéma.
Qui finance les films, d’où vient l’argent, de qui sommes-nous complices lorsque nous le dépensons, lorsque nous pratiquons notre art ? A quoi avons-nous renoncé, avec quoi avons-nous dû trouver des accommodements lorsqu’il a fallu nous adapter à la demande d’un marché, d’une industrie, qui dictent leur loi ? De quelle chaîne de télévision, ayant fondé son audience sur quelle démagogie, approuvons-nous les pratiques ? A quelle demande fantasmée, à quel « grand public », méprisé par ceux qui prétendent parler en son nom, nous sommes-nous pliés
Ainsi avec quinze ans de retard ai-je découvert que mon film Les Destinées sentimentales avait été distribué aux Etats-Unis par une société, fort sympathique au demeurant, dont le principal actionnaire se trouvait être l’agitateur d’extrême-droite Steve Bannon. Suis-je à l’aise avec cela ? Non. Ai-je le choix ? Je ne sais pas, peut-être, en tout cas les choses seraient bien plus claires si ces enjeux étaient débattus, posés noir sur blanc. Et cela vaut tout aussi bien pour les méga-productions américaines adaptant leurs scénarios aux exigences de la censure politico-confucéenne du régime chinois afin de toucher le public le plus vaste de la planète.

Je pense souvent au titre d’un article de François Truffaut intitulé, ironiquement « Clouzot au travail ou le règne de la terreur ». Il faut faire justice comme l’a fait Truffaut à l’image alors répandue, aujourd’hui plus diffuse, du cinéaste démiurge, abusant de son autorité et de son pouvoir, au profit d’une quête indicible, d’un absolu aussi vague que peu formulable et dont les caprices, les colères, la désinvolture aussi, seraient autant de manifestations tangibles, mais pourtant inaccessibles au commun des mortels. Je considère l’inverse, que le cinéaste a des comptes à rendre à son équipe et que la qualité de concentration, la richesse du partage, la clarté des intentions font partie, et de façon déterminante, de cette aventure collective qu’est un tournage. J’ai souvent, chaque fois que j’en ai eu l’occasion, remercié les équipes de mes films et rappelé combien le cinéma est la somme d’énergies relayées par un réalisateur dont l’art tient souvent à sa capacité d’écoute, d’attention aux idées, aux flux qui naissent au jour le jour sur un plateau. Son talent tient aussi à savoir les susciter. C’est pour moi une conviction ancienne, profonde, que le meilleur du cinéma tient à la qualité de l’engagement de chacun dans une étrange entreprise qui a à voir avec la réinvention, le réenchantement du réel, mais qui est aussi un monde parallèle, une vie parallèle où chacun doit pouvoir se dépasser, s’accomplir et, d’une certaine façon, donner un sens à ce qui est un peu plus qu’un travail, mais plutôt l’engagement d’une vie, une quête intime.
Cela ne signifie en rien que je renierais ce que j’ai souvent affirmé, à savoir que la mise en scène est avant tout une force de disruption dans les automatismes qui structurent le fonctionnement d’un plateau. C’est en effet à elle de remettre constamment en cause ce qui relève des conventions, des facilités, d’une forme qui n’est vivante que si elle est constamment bousculée, interrogée : et plus on la bouscule, plus on refuse de se contenter des réponses toutes faites, plus on met en œuvre cette conviction que le cinéma peut et doit être mille choses – ce qu’il a été autrefois, ou ce qui lui reste à explorer, que ce territoire est infini et le seul qui mérite vraiment d’être exploré – plus on a des chances de révéler ce qui est le sens même de notre art et sa place dans le monde. Mais rien de tout cela ne peut être accompli seul, cela doit être prolongé, approfondi, mis en application par chacun, avec tous les risques que cela comporte et avec l’exigence qui seule permet de mener cette ambition à bien.
Cela vaut pour tous les tournages et pour tous les cinéastes dès lors que ceux-ci ont choisi de pratiquer leur art en dehors des lois et des règles de l’industrie du flux et ont su préserver, souvent de haute lutte, leur liberté – qui au cinéma est la valeur suprême – à leur profit bien sûr mais aussi, et tout autant, à celui de leurs collaborateurs. Un film c’est un microcosme, toute la société y est représentée, selon toutes ses strates, et il est traversé par les mêmes ondes, les mêmes tensions, seulement ces valeurs y sont mises à l’épreuve de façon plus immédiate, plus urgente, au jour le jour et avec des conséquences aussitôt observables. C’est en cela que j’accorde une valeur inestimable à une pratique éthique du cinéma dont les bienfaits, les bonheurs comme les dangers seraient partagés par tous, en somme un travail désaliéné au sein même du territoire de l’aliénation. Je parlais de comptes à rendre, c’est à mon sens au respect de ces valeurs qu’il faut d’abord pouvoir soumettre son œuvre.
On l’aura compris, je n’aime pas beaucoup ce qu’est devenue l’industrie du cinéma à présent entre les mains de cadres qui ressemblent plus aux responsables d’entreprises issus, comme partout, d’écoles de commerce, ou encore de hauts fonctionnaires, souvent des gens de grande qualité mais dont les réflexes, les ambitions, l’imaginaire, sont à mille lieues de ceux des aventuriers, des joueurs, des visionnaires qui ont bâti cette cathédrale qui nous est commune, et qui est celle du premier siècle du cinéma.
En cela j’ai toujours mis ma Foi dans ce qu’on appelle le cinéma indépendant – des structures dont le modèle historique serait Les Films du Carrosse de François Truffaut ou Les Films du Losange de Barbet Schroeder et Eric Rohmer – mais ce serait négliger l’œuvre de producteurs qui ont su, dans les taillis souvent hostiles des diverses instances du financement du cinéma, dans les méandres du système bancaire, su accompagner, hors de toute logique de profit, encore bien heureux de ne pas en être de leur poche, les œuvres singulières, atypiques, voire antagonistes des valeurs en cours, d’auteurs authentiques, eux-mêmes portés par pas grand chose d’autre que leurs convictions, leurs obsessions mais aussi leurs limites et leurs fragilités, matière première de leur œuvre.
C’est cet écosystème, qui se reformule selon les cultures et selon les pays, plus ou moins dépendant d’une législation favorable au cinéma, ou du mécénat, ou encore de rien du tout, qui a maintenu vivantes la réflexion, la recherche, les audaces et tout d’abord une forme d’intégrité indispensable à la meilleure pratique du cinéma.
On a vu grossir la vague du cinéma de flux, on a vu le cinéma devenir une industrie, et cette industrie elle-même devenir dominante, j’hésite à employer les termes d’abrutissante, d’aliénante qui, il n’y a pas si longtemps, seraient venus naturellement sous ma plume sans que j’aie besoin de m’en justifier. Pourtant là où, à d’autres époques, on pouvait rêver du cinéma en tant qu’utopie, il me semble qu’il est devenu parfaitement dystopique, et que sous couvert de divertissement ou encore badigeonné de bien-pensance et de très fades bons sentiments, il est pour l’essentiel consacré à la perpétuation, et à la flatterie, des émotions les plus convenues et les désirs les plus bas quand ce ne sont pas les plus niais. En cela je finis par me contenter qu’un film, faute de se préoccuper de la nature, de la lumière et de l’humain, s’abstienne au moins d’être néfaste.
C’est pourquoi au fond, aujourd’hui, c’est contre le cinéma que le cinéma doit se faire. En particulier s’il veut, au sein du nouveau monde des images, incarner le plus précieux, le plus vital, c’est à dire la liberté de penser, d’inventer, de chercher, d’errer et de se tromper, en somme d’être l’antidote dont nous avons besoin pour préserver notre foi, pour maintenir vivante une flamme, qu’il est de notre devoir de savoir protéger et transmettre, génération après génération, dans un combat qui jamais n’est gagné.
Mars - Avril 2020
Par analogie avec des initiatives similaires dans d’autres arts, Sabzian a lancé en 2018 une tradition annuelle : une invitation pour écrire un State of Cinema et pour choisir un film y correspondant. Une fois par an, le cinéma est ainsi passé au crible par un texte qui le défie, l’interpelle, le dirige ou justement refuse toute détermination, le met à l’épreuve et en péril, lui fait un procès, l’embrasse, le glorifie ou le maudit. Un plaidoyer, une déclaration, un manifeste, un programme, un témoignage, une lettre, des excuses ou peut-être même un acte d’accusation. Mais dans tous les cas, un appel à réfléchir sur ce que le cinéma signifie aujourd’hui, sur ce qu’il pourrait ou devrait signifier.
Pour la troisième édition le 26 juin 2020, Sabzian a eu l'honneur d'accueillir le cinéaste français Olivier Assayas. Il a choisi Zerkalo [Le Miroir] (1975) d'Andrei Tarkovsky. Malheureusement, en raison de la pandémie du covid, la projection de ce film ne pouvait pas avoir lieu. Assayas a présenté son State of Cinema par un live vidéo.
La version originale française de la conférence "Le temps présent du cinéma" d'Olivier Assayas a été publiée en juin 2020 par Gallimard dans la série "Tracts", une collection de courts essais.